L’île de l’éternité de l’instant présent
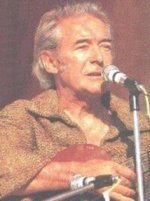
Félix Leclerc
Le dernier été de sa vie, celui de l’an 2000, fut le plus mystérieux de tous pour ceux qui l’avaient connu jeune artiste. Il chantait au théâtre « Le patriote » de Sainte-Agathe durant le souper, et cela six soirs par semaine, juste avant le spectacle des « girls » de Clémence Desrochers. Mais avec cette particularité qu’il s’était arrangé pour qu’on ne le voie pas. Il montait par une échelle jusqu’à la cabane de l’éclairagiste soudée au plafond intérieur et de là, fredonnait les chansons les plus sensibles du répertoire de sa jeunesse dans le Vieux-Montréal.
Renaud chantait dans ce qu’il surnommait lui-même, la plus petite boîte à chansons du Québec, à cause de sa forme carrée avec à peine de la place pour deux personnes debout. Il y déposait côte à côte, son lourd cahier de 800 chansons, de quoi grignoter, une bouteille d’eau et son journal personnel ouvert à la page blanche du soir, alors que, dans son dos, le baladeur d’éclairage frôlait ses épaules de sa rugosité métallique.
Enfin, il pouvait séparer le paraître et l’être, laisser l’expression de sa voix chaude frissonner dans le théâtre avec la délicatesse de l’intimité comme le fait une bouteille de vin à table. Il attendait chaque soir le moment précis ou son ego se dissolvait dans une béatitude totale, toujours la même et jamais pareille, d’une telle beauté qu’il lui arrivait de perdre connaissance de bonheur sur son banc, le visage bien écrasé dans son cahier.
Il s’abreuvait depuis toujours aux frissons de l’éternité. Cela lui semblait si naturel qu’il n’avait jamais pu comprendre comment il se faisait que l’on puisse souffrir. Son corps de 51 ans lui avait toujours paru en état de jeunesse. La pureté de l’âme, la sensation continuelle de flotter deux pieds au-dessus du sol, le rythme lent, amoureux, étonné, charmé. La sensation de ne rien peser, de se fondre dans le tout avec ravissement, de saisir dans ses mains l’air comme des milliers de pépites d’or. Était-il artiste, poète de la vie, amant de l’être ou son enfant naissant encore aux langes ?
D’en haut, il s’émerveillait de la beauté des humains lorsqu’ils partagent un repas. À un point tel qu’il se faisait un plaisir profond de descendre saluer tout le monde, un par un en disant :
Bonsoir
Je suis votre chanteur fantôme
Je vous souhaite une bonne soirée
Il arrivait qu’il s’aperçoive que certains soient émus parce que telle chanson leur rappelait tel souvenir. Dans ces moments-là, il ralentissait la voix, pénétrait le texte pour que l’instant présent se dénude de facticité afin de s’inonder de lui-même d’éternité.
Il résidait depuis trente années, de façon ponctuelle, dans l’ancienne maison du chansonnier Raymond Lévesque, l’homme de « quand les hommes vivront d’amour « à dix pieds exactement du théâtre de la Butte où était né le mode d’expression chansonnier au Québec. Ce qui lui avait permis de construire, pierre par pierre, de la maison à la butte, un chemin menant sous cette scène historique où un jour seraient déposées ses cendres.
En fait, il vivait en locataire de la vie chez un ami chansonnier à Val-David comme un vagabond emprunte les sentiers qui lui donnent le bonheur de marcher. À cinq minutes à pied de la rivière du parc des amoureux où il aimait s’épanouir en contemplation, huit minutes de l’hôtel la Sapinière où il adorait se bercer dans la balançoire, quinze du Mont Condor où il sautillait la forêt des Alpinistes et quatre du café chez Steeve où il assiégeait discrètement la table du fond, visage enfoncé dans le mur, pour ne pas être dérangé.
Ajoutez à ça un vieux camion 1977 où l’on pouvait marcher à l’intérieur, dormir au fond et lire des heures étendu sur le plancher. Que du dépouillement, que du minimalisme. D’ailleurs dans cette maison de 14 pièces, il n’en habitait qu’une, meublée par un petit lit simple, un réfrigérateur douteux, une dizaine de morceaux de linge et quelques ustensiles.
Était-il si différent des autres ?. Il lui semblait que non.
Sa vie avait été semblable à celle du Petit Poucet. Au lieu de semer des cailloux, il avait fait trois enfants à trois femmes différentes, au travers de quelques centaines d’aventures d’un soir, le tout inhérent à sa vie de jeunesse autant qu’aux attributs de son métier, jamais de maîtresse. Puis, tout s’était clairsemé, le tour du jardin des désirs pulsionnels l’ayant repu.
Les enfants avaient vécu avec leur mère, trop insécures face à l’effarante liberté de sa libre-pensée. Pour ses ex-femmes, il était un irresponsable inadapté qui, même s’il payait ses pensions, ne pourrait qu’avoir une influence néfaste sur leurs poussins en leur montrant comment se conduire de façon créatrice face à une société institutionnalisée.
Il ne fréquentait personne, jamais personne. Il passait seulement dans la vie des gens comme on se croise quelquefois dans la rue. Mais il saluait avec amour ceux et celles dont le cristal du cœur le faisait frissonner de joie à l’intérieur de lui-même.
Par exemple, la femme la plus pauvre du village. Si maigre que le soleil refusait systématiquement de traverser son corps de peur de la faire fondre. Si laide, que les chats, d’une fois à l’autre, refusaient de suivre son ombre rectiligne. Celle-ci, foulard sur la tête, les yeux hagards d’acceptation, semblait immunisée contre quelque regard de qui que ce soit.
Traînant un petit chariot sur deux roues, été comme hiver, elle vendait, pour survivre, les œufs de ses poules, à qui voulait bien en acheter sans jamais mendier un nouveau client. Et quand elle manquait de marchandises, elle allait chez l’épicier du village pour acheter la douzaine que ses poules avaient omis de lui pondre
Cela faisait maintenant près de 25 ans qu’ils se croisaient d’un sourire à l’autre. L’ermite ne lui avait jamais acheté d’œufs. Il ne savait même pas son nom. Il avait maintenant peur qu’elle meure, qu’elle disparaisse de son bonheur de vivre. Il était attaché à elle comme on l’est d’un saule pleureur lorsqu’il annonce de ses plaintes la venue de l’automne.
En cet été 2000, il désirait lui dire autre chose que son habituel admiratif :
Bonjour, Madame
De fait, il modifia :
Bonjour, Madame. Ça va bien aujourd’hui ?
Il lui serra tendrement le bras de ses deux mains. Elle ne fut pas surprise outre mesure.
Vous savez. Continua-t-il,
Ça fait 25 ans cette année que l’on se salue
Et vous ne m’avez jamais vendu d’œufs.
La réponse de la dame pauvre le conquit d’état de grâce :
Ça n’a pas adonné Monsieur
Et ils poursuivirent chacun leur chemin.
Ce qui permit à l’ermite, comme le rituel l’avait dessiné depuis toujours entre eux, de remplir son cœur de cette bienveillance que la vie offre en prime lorsqu’on lui est abandonné.
Il aimait les gens de son village. Mais de loin. Ma Tante Marie s’occupe-t-elle encore des pauvres ? La grande blonde a-t-elle pu aller à sa réunion des alcooliques anonymes ? L’agent d’immeuble a-t-il enfin trouvé l’âme sœur?
De fait, il avait fait des êtres de sa vie au quotidien un manège de respect et de civilité qui tournait magiquement autour de ses silences comme de ses absences. Un matin cependant, un détail annonça de grands bouleversements à venir. Il avait vu Réal Dubois, le propriétaire de la buanderie du village, avec une casquette sur la tête qu’il oublia d’enlever en le saluant, lui qui avait toujours vécu la fierté de l’homme à la chevelure dégagée. Le chanteur pressentit que celui-ci avait un cancer.
Le matin suivant,il croisa Madame Dubois qui semblait différente des autres fois. À travers les années, ils s’étaient dit à peine bonjour ou bonsoir. Mais cela avait créé entre eux une délicatesse telle qu’il pressentit, à son pas vif et saccadé, une détresse inhabituelle. Alors il ralentit le sien au cas où elle aurait aimé se confier.
Réal se referme sur lui-même lui dit-elle
Il rejette mon aide, il se choque après moi
Je n’en puis plus
La femme pauvre aux œufs d’or passa tout près d’eux, puis l’agent d’immeuble, comme ils le faisaient habituellement à cette heure.
Madame Dubois, murmura l’ermite,
Votre homme vous aime comme il vous a toujours aimé.
Il est juste en colère après la vie.
C’est une bête traquée par une maladie dévastatrice.
Il tente de se battre seul
Pour épargner de la souffrance à sa famille
Et tous deux avaient pleuré doucement
Puis un autre événement majeur était survenu pouvant affecter le tournoiement des heures sous forme de chevaux courbant le temps.
Depuis trente ans, il adorait passer en face d’une maison où vivait un couple d’artistes dont il avait toujours admiré la complicité. Ce matin-là, il vit une pancarte à vendre. Même s’il ne leur avait jamais parlé, il ne pouvait supporter l’idée de les voir disparaître de son ordinaire de marche. Alors, il se rendit à l’atelier par derrière. L’homme ciselait, comme il le faisait habituellement à cette heure-là, un morceau d’ébénisterie.
Monsieur, dit-il, je ne vous connais pas
Mais vous ne pouvez pas déménager
Ça fait 30 ans que je me promène devant chez vous
Le rythme amoureux de votre vie de couple me fait un bien énorme
Mon bonheur d’être ne sera jamais pareil
Sans la beauté de votre présence.
L’homme avait été touché. Il lui avait fait visiter l’intérieur de la maison, l’avait présenté à sa femme et même permit de jeter un coup d’œil aux peintures de celle-ci. Finalement, la pancarte fut retirée. Dans la même période, l’hôtel La Sapinière avait déménagé sa balançoire sans l’avertir. Il en avait été blessé. Ce ne serait plus le même rythme, les mêmes arbres, la même beauté d’ombrages. Il était allé voir la gérante pour porter plainte, même s’il n’était pas client. Celle-ci le prit pour un hurluberlu, tout en lui souriant professionnellement.
Une semaine plus tard, Renaud mourut, et je perdis, sans même avoir eu le temps de le revoir, l’amour de ma jeunesse.
Et sa vie s’effaça du réel comme un éclair dans le ciel. Mais vous auriez dû voir cet éclair d’homme quand il avait vingt ans. C’était un chanteur fougueux au café St-Vincent du Vieux-Montréal et un gardien des légendes des plus magiques dans un camp de vacances pour enfants des services sociaux en attente de placement, le camp Ste-Rose.
Mais aurais-je eu le coup de foudre pour lui s’il n’avait pas ressemblé si profondément à mon père ? Car mon père avait été aussi un mémorable conteur. Toute petite, il m’avait appris à lui demander :
Papa, est-ce que moi aussi un jour
Je connaîtrai le grand amour ?
Il me répondait alors en déclamant :
Si chaque nuit tu en fais la demande à la vie,
Elle te rendra plus fougueuse que Scarlett Ohara
D’autant en emporte le vent,
Plus gémissante qu’Héloïse pour Abélard
Dans la nuit des temps,
Plus pure que Juliette dans les bras de Roméo
L’embrassant
De telle sorte qu’un soir, un mystérieux soir
Un beau prince, ombrageux et charmant
Posant genou aux pieds de tes royaux atours
T’offrira et son cœur et son or
Et la terre entière chantera
En cet instant présent
Ils vécurent heureux
Et eurent beaucoup d’enfants
Au paradis…Millénaire
De la poésie des bien-aimés
De l’île de l’éternité
Plus tard, que j’eusse six ou douze ans, lorsque je ne comprenais pas le sens d’un mot, il sortait le volume encyclopédique approprié et en tirait les deux phrases les plus musicalement significatives que nous apprenions tous deux par cœur, juste pour le bonheur du dire, la complicité du vivre, parce que ça sonnait joli comme il aimait le répéter sans cesse.
Mon père adorait l’encyclopédie. Il y avait découvert par la lecture systématique d’un page par page tenace des perles intellectuelles qui lui avaient permis, entre autres, de s’affranchir de toute religiosité. Par exemple, dans l’item « Brahmanisme », section philosophie, il avait débusqué une suite de lignes qui avaient changé sa vie. Il l’avait apprise par cœur, comme tout ce qu’il découvrait d’ailleurs, pour suppléer à une culture qui lui faisait cruellement défaut, n’ayant réussi qu’une cinquième année chez les religieuses.
Brahmanisme : Philosophie
Le divin mythique qui est à la base des croyances et des cultes N’est, aux yeux des philosophes, Qu’un réceptacle au nom indifférent Le but essentiel étant la réalisation du divin.
C’est donc grâce à Larousse qu’il cessa d’aller à la messe.
Papa, lui demandai-je un soir,
Qu’est-ce que la poésie ?
Je me rappelle ce soir-là. Je devais avoir onze ans. Il prit le temps de déguster les différents sens du mot « poésie » de la page 586 à 587 (Larousse1961). Je savais depuis toujours que, durant ses expéditions dans la forêt des mots, je devais garder un silence respectueux jusqu’à ce que, de ses lèvres, surgisse la substance de ce qu’on allait adorer tous les deux. Il prit un crayon à mine, souligna d’un trait d’un fini rectiligne, deux extraits qu’il me lut, de suite, comme s’il avait trouvé le plus inestimable des trésors.
Le poète
Est celui qui découvre
L’immuable virginité du monde
Retrouvant les dons et les vertus de l’enfance.
La poésie,
Elle, n’est évasion du réel
Que pour être invasion de l’essentiel.
Qu’est-ce que l’essentiel lui demandais-je ?
L’essentiel
C’est l’île de l’éternité de l’instant présent
Comme il parlait d’une île, je n’en demandais pas plus, n’attendant que de vieillir pour aller la visiter. Telle cette île d’où provenait Jacques Cartier, le navigateur, dont il me chantait les paroles pour que je m’endorme : A St-Malo Beau port de mer
À St-Malo beau port de mer (2)
Trois beaux navires sont arrivés
Nous irons sur l’eau
Nous irons nous nous promener
Nous irons jouer
Dans l’île
Dans l’île
Il n’en demeurait pas moins, qu’au réveil le lendemain, j’étais certaine de retrouver sur un grand tableau noir recyclé de sa communauté religieuse dont il était, depuis dix ans ,l’homme de maintenance, les mots « poète » et « poésie » suivis de leur définition avec en bas, n’ayant jamais quitté la bordure du tableau, les mots :
L’île de l’éternité de l’instant présent.
Sous la bordure du haut, le tableau, pour m’apprendre à lire et à écrire, mentionnait trois noms : Marie Gascon et celui de mon père et ma mère : Rodolphe et Marguerite. Mais en réalité, on m’avait toujours surnommée MIEL, à cause de mon teint parsemé de petites taches.
Parfois, quand je revenais de l’école et que je me plaignais parce que je n’avais pas de vêtements à la mode, ou que je ne mangeais pas assez souvent au restaurant, mon père exigeait respectueusement, d’un air sévère mais bienveillant, que je ferme les yeux pour déguster avec lui le récit oral d’un texte qu’il considérait comme sacré. Il disait qu’on en avait trouvé le parchemin enfoui dans une bouteille lancée à la mer directement de l’île de l’éternité de l’instant présent habitée par un certain Monsieur Renoir, peintre de son métier. On pouvait y lire ceci :
Je me rappelle
La merveilleuse sensation de légèreté
De ne rien posséder
Qui nous permettait, à Monet et à moi,
De végéter les deux mains dans les poches…
Il faut toujours être prêt à partir
Pour le bon motif
Pas de bagages, une brosse à dents
Et un morceau de savon
Et mon père concluait par une phrase envoyée à la mer elle aussi sous forme de bouteille par le peintre Gauguin, voisin sur la même île, lorsqu’il vécut le paradis de l’amour dans les bras de sa tahitienne Teha’amana
Et le bonheur succédait au bonheur
Oui, mon enfance fut cathédralement magique. Dès l’âge le plus naïf, je pris l’habitude d’écrire mon journal. Et je le faisais lire à mon père qui l’annotait régulièrement dans la marge de quelques-unes de ses réflexions à mijoter pour plus tard, comme il me disait souvent, ma mère préférant ne pas en prendre connaissance.
Son Rodolphe, comme elle aimait l’appeler, m’avait ciselé une bibliothèque qui contenait chacun de mes journaux intimes depuis l’âge de trois ans, les premiers naturellement contenant plutôt des griffes de dessins maladroits. Et tout en haut, il avait inscrit en sculptant artistiquement dans le bois :
Instants présents
De miel en miel
Papa lui demandai-je un jour
Qu’est-ce que l’instant présent ?
Ce jour-là, mon père ne courut pas vers l’encyclopédie comme il en avait coutume à chacune de mes questions. Ses yeux devinrent étrangement lunatiques, comme s’il réfléchissait à une interrogation à laquelle toute réponse en soi demande de la magie, puisqu’elle n’existe peut-être pas
L’instant présent, miel, c’est le plus beau des présents
Offert par les habitants de l’île de l’éternité
À ceux de la planète terre où la souffrance du passé
Se console aux espérances de l’avenir.
Tout cela me semblait inaccessible et bien mystérieux. Valait mieux chanter la chanson de l’île comme finissait par dire mon père, la musique témoignant parfois mieux de l’essentiel que les paroles qui l’accompagnent.
À St-Malo beau port de mer (2)
Trois beaux navires sont arrivés
Nous irons sur l’eau
Nous irons nous nous promener
Nous irons jouer
Dans l’île
Dans l’île
À l’âge de quinze ans, j’écrivis dans mon journal :
J’attends avec passion le grand amour
À quoi bon mordre dans mon adolescence
Puisque toute cette agitation des expériences
Puériles m’ennuie.
À la lecture de cet extrait, mon père écrivit en haut de page, pour que je ne puisse rater son dire :
Miel, il n’est peut-être pas bon
De t’enfermer en toi-même
Comme tu le fais ?
Chaque âge a son devoir de vivre.
Mais je refusais systématiquement tout ce qui aurait désembelli mes rêves. J’escamotais des sorties avec les garçons, danses, fêtes d’enivrement en cachette des parents. Je brûlais d’un feu si pur qu’il me semblait terriblement ennuyeux d’aller m’évaporer en douteuse compagnie. Je préférais dévorer les livres de toutes sortes à la bibliothèque municipale, dont quelques lubriques tel le marquis de Sade ou l’amant de Lady Chatterly, pour au moins acquérir la culture du désir.
Quelques années plus tard, je lus tant et tant que je me retrouvai en littérature à l’Université de Montréal. Pour payer mes études, mon père trouva un emploi au noir la fin de semaine et ma mère accumula de la couture pour le compte d’une manufacture des environs. Que de dimanches nous cousîmes ensemble. Mon père disait souvent, en souriant, que les princesses attendent toujours le prince charmant en brodant de longs et beaux ouvrages. Devant le nombre de soutiens-gorge à terminer pour le lundi matin, j’avoue que ma mère et moi ne trouvions jamais cette taquinerie très à propos.
En juin 1973, je terminai mon baccalauréat. J’avais comme projet une thèse de maîtrise sur la relation « Roméo et Juliette » et le reste de l’œuvre de Shakespeare, avec comme tuteur un homme charmant au nom de John Thysdale. Sa famille étant originaire de Vancouver, il espérait obtenir un poste de prestige à son alta mater universitaire, me faisant miroiter la possibilité de m’y emmener comme assistante de recherche si le destin lui était favorable.
Être ou ne pas être, voilà la question , me dit-il en riant
Ce serait formidable que vous y soyez.
Mais je pris ces propos pour de la badinerie galante provenant d’un homme marié et de toute façon trop âgé pour moi bien qu’attrayant de sa personne et ne m’en souciai pas plus qu’il faut. Je me rappelle avoir fêté mes 21 ans, seule devant un verre de vin à la santé de mon intentionnelle pureté physique. Je n’osais prononcer le mot « virginité » car cela aurait risqué de trop me déprimer, je crois. Je préférais enterrer le mot sous la passion de mes sens confus à faire exploser, le plus tôt possible, sous le feu d’un grand amour.
J’habitais encore chez mes parents et je continuais d’écrire mon journal. On ne quitte pas facilement le bonheur permanent. Mon anniversaire était toujours l’occasion d’un cadeau particulier de la part de mon père. Depuis ma naissance, à chaque fête, il m’avait toujours sculpté un délicat coffret de bois cadenassé et annoté de l’année avec un mot d’amour glissé à l’intérieur écrit spécialement pour l’occasion.
À n’ouvrir qu’une fois adulte,
M’avait-il répété d’une année à l’autre.
Tu es adulte maintenant,
Tu as vingt et un ans.
Il est temps d’ouvrir les coffres, me dit-il.
Presque plus excité que moi
Je serai une adulte
La journée où j’aurai rencontré mon prince charmant
Pas avant, répondis-je en riant.
Curieusement, c’est ici que commence mon histoire avec Renaud. Quel préambule, Renaud à cinquante et un ans et toute mon enfance avec mon père, juste pour tenter de dessiner émotivement le bonheur parfumé de ce premier instant d’où surgit, sous forme de coup de foudre, l’essence de l’homme qui envoûta le reste de mon existence.
Nous étions de la même race. Impossible de ne pas se miroiter du premier regard. Nous habitions tous les deux le pays du bonheur, moi par naissance et lui par passion de le partager aux autres. Et comme la vie ne fait jamais les choses à moitié, elle nous avait dirigé l’un et l’autre vers le continent de la souffrance, plus précisément au camp Sainte-Rose de Laval, au milieu d’enfants dont les familles étaient trop dysfonctionnelles pour s’en occuper.
Mon père m’avait appris à reconnaître cette contrée par sa façon d’accorder la priorité à la mémoire du passé en la noyant d’avance dans un certain futur. On souffre trop pour déguster la vie et l’on rêve trop de s’en sortir pour croire que c’est « maintenant » seulement qui en constitue la porte d’entrée et de sortie. On vit dans une maison dont on ne peut toucher les murs. On porte le nom de sociaux affectifs. Ceux et celles qui jouent les rôles de père et de mère se remplacent par chiffres de huit heures et se reconnaissent par les mots « éducateurs et éducatrices ». On se sent institutionnalisés. Dort en même temps, mange en même temps, jamais seul ou seule dans une chambre, sauf quand on est mis au rancart dans un coin pour avoir mal agi. Et l’on a peur, constamment peur d’un je-ne-sais-quoi. D’une horrible réalité que des mots d’enfant ne peuvent nommer. Une mince voix gémissant au creux des yeux tristes : Nous sommes les petits errants de l’existence, les « sans nom » de l’ignorance, la miniature cour des miracles du temps qui n’en finit plus de passer et repasser sans vraiment nous apercevoir. Nous sommes les exclus de l’amour.
Qu’est-ce que l’enfance sur ce continent ? Ça se vit dans les filets des services sociaux, d’une famille d’accueil à une autre parce qu’on a traversé l’inceste, la violence associée à la drogue, à l’alcool ou autre dépendance majeure. On se sent ballottés dans un train, celui d’adultes étrangers qui nous amènent faire une longue promenade jusqu’à la gare des dix-huit ans.
Ainsi, le camp Ste-Rose se divisait en trois modules : Les castors, les hiboux et les écureuils. J’étais l’éducatrice du dernier groupe, celui des écureuils.. D’une part, Jean-François treize ans, fils d’un père membre de la pègre, qui pouvait vous tuer d’un seul regard et Natacha douze ans qui m’avait adoptée comme mère et qui travaillait pour que j’eusse envers elle les mêmes sentiments. Et d’autre part, la plus que grassette Chantal et la grande Monique toujours en guerre parce que mal dans leur peau d’antagonistes se moquant des deux jumeaux de huit ans qui avaient passé une partie de leur vie dans une garde-robe et qui ne parlaient pas encore. Entre ces deux clans, des enfants qui partaient et repartaient selon les évènements externes sur lesquels je n’avais aucun pouvoir. C’est ainsi qu’on apprend à ne pas s’attacher pour ne pas souffrir inutilement.
Ma préférée était Natacha, Natacha Brown. Sa mère, psychotique s’était suicidée et son père avait sombré de désespoir dans les abîmes de l’alcool. Elle lisait dans mon âme presque à la perfection. Elle me secondait discrètement quand la violence ou la tristesse sous forme de larmes éclatait dans le groupe. Sans que les autres ne le sussent jamais, elle fut ma préférée, mon unique, mon indispensable. Le 27 juin 1973, vers vingt heures, une ronde d’enfants et d’adultes au visage peinturé, avec plume d’indien au front et couverture sur le dos, envahit la salle communautaire dans le but d’accueillir le nouveau gardien des légendes que personne n’avait encore rencontré. Comme il s’appelait Anikouni, on répéta la chanson parlant de ce personnage de l’imaginaire.
ANIKOUNI SHA A HOU A NI (2)
AH WAWA BIKANA SHAHINA (2)
ELEAONI BIKAWA YA WA (2)
Robert, le directeur opérationnel du camp, demanda soudainement le silence. C’était un homme maigre et élancé pour qui le sens des responsabilités équivalait à un taux de stress intense. Il avait toujours peur à un accident ou même un suicide, ce qui aurait terni l’éclat et la réputation de son personnel dont il respectait profondément la droiture et l’engagement. Tous faisaient leur possible dans une situation potentiellement explosive. On ne pouvait que tendre une corde dans un abime de manque d’amour. Il avait donc expliqué aux enfants le sens des mots indiens de la chanson Anikouni
Anikouni, Toi qui parcours , lacs et rivières
En canot d’écorce rapiécé de tes mains
Ramène-nous la force
Au pays où hier se dessine en demains.
L’événement aurait pu être banal. Mais il fut plutôt chorégraphie d’apprivoisement d’un imaginaire à un autre. Un chef indien, corne au cou, magnifique panache sur la tête, entre s’assoit au milieu sans cesser de jouer du tamtam. Soudain, sans arrêter de marteler le rythme, il incite des yeux un de mes jeunes, Jean-François, à le rejoindre. Ils sont maintenant deux. Puis ce complice continuant seul à battre le temps comme on bat parfois un tapis sur la corde à linge pour le libérer de sa poussière, Anikouni se lève. Par le seul mouvement de son corps dessinant l’espace en collines et vallées, il entraîne les enfants dans des jeux de mains dont l’ensemble orchestre l’air et l’atmosphère. Et tout devient jeu autour de lui. Et lui s’habille de quête. Il cherche, d’un visage à l’autre. Parfois il se retourne pour exprimer en deux ou trois sourires sa soif que rien de cela ne cesse.
Il s’immobilise devant mon groupe. Il suffit que je vois ses yeux pour que la foudre s’élance en moi en un coup terrible, dans un éclair qui me rendit fragile et allumée telle une biche prise au piège alors que le feu de forêt de ce que l’autre dégage s’avance vers elle sous la simple levée du vent des passions, imprévisible en ses tourbillons autour de l’une comme de l’autre.
CAIA… BOUM…
Dans tous les camps de vacances du Québec, ce cri de ralliement permet à un animateur d’obtenir des enfants qu’ils s’assoient sans réplique et surtout qu’après le boum, le silence rayonne de sa personne vers le groupe avec la même exigence d’obéissance aveugle que met le soleil à brûler les yeux de ceux qui oseraient l’impolitesse d’un regard délinquant. Et tout bruit cessa, de quelque nature musicale qu’il soit.
Ce chef indien que je n’avais jamais vu auparavant sortit un parchemin d’écorce de bouleau et lut simplement en me regardant dans les yeux, tout en reculant dans le velours des pas perdus pour le bonheur de se perdre :
Dans la grande tribu des yogs,
Quand un jeune indien…
Tombe amoureux d’une princesse
Il doit gravir la montagne sacrée
Déjouer le gardien de la caverne sacrée
Pour voler le feu de l’amour
Il se mit à zigzaguer, à tourner à l’intérieur du cercle, regardant chaque visage, les bras en mouvement. Puis, s’abandonnant au jeu indien, il mit un genou devant moi, comme si le sol avait été couvert de branches de sapin.
Fille de la forêt,
princesse de la lune et des étoiles,
La foudre a frappé mon cœur de passion pour le vôtre
Qui a déjà vécu un coup de foudre comprendra qu’il te laisse dans un état semblable, non pas au tremblement de terre, mais à la vision cauchemardesque qui suit quelques secondes après, comme si tout ce qui donnait un sens à ta vie s’en trouvait enseveli. Il ne reste que toi et lui, main dans la main regardant du haut de la colline le présent se moquant du passé.
Il se releva
Amis yogs…Tribu des castors….
Tribu des hiboux….Tribu des écureuils….
Je suis amoureux de cette princesse
Je dois retrouver le feu de la caverne sacrée
Et le lui ramener afin qu’elle m’accorde
Son amour éternel
Il entonna alors un canon.
Zum galli galli galli zun
Galli galli zum
Les enfants l’apprirent si vite qu’ils purent continuer seuls. Et Anikouni chanta le couplet en harmonie avec leurs voix.
Le feu de l’amour brûle la nuit
Je veux lui offrir pour la vie.
Et c’est sur la musique de cette chanson, que les enfants, couverture sur le dos et flambeau aux mains de leurs éducateurs ou éducatrices, le raccompagnèrent à son canot . L’indien rama le lac et disparut dans le noir. Et le noir disparut aussitôt dans le cœur des enfants, l’espace d’un instant, comme il en existe tant sur l’île de l’éternité de l’instant présent.
Commentaires
1. Le dimanche 27 janvier 2008 à 16:40, par Gisele
Salut PIERRE,
Merci encore d’avoir été là à NOEL 07. Tu as été mon cadeau du ciel. Comme tu le
sais, maman est décédée le 16 décembre dernier.Tu es la preuve pour moi que nos vibrations se rejoignent dans l’UNIVERS et que notre
contact, même si elle n’est plus de ce monde, est véritable et réel.Depuis des années, maman a toujours été avec moi à NOEL. Grâce à toi, elle était là
encore avec nous cette année, et, ce fut un moment magique…Quand on a la foie, nos rêves se réalisent et la vie nous rend bien ces moments
intenses de GRAND BONHEUR.Je ne t’oublierai jamais
Je t’embrasse très fort.G I S E L E
 À propos
À propos